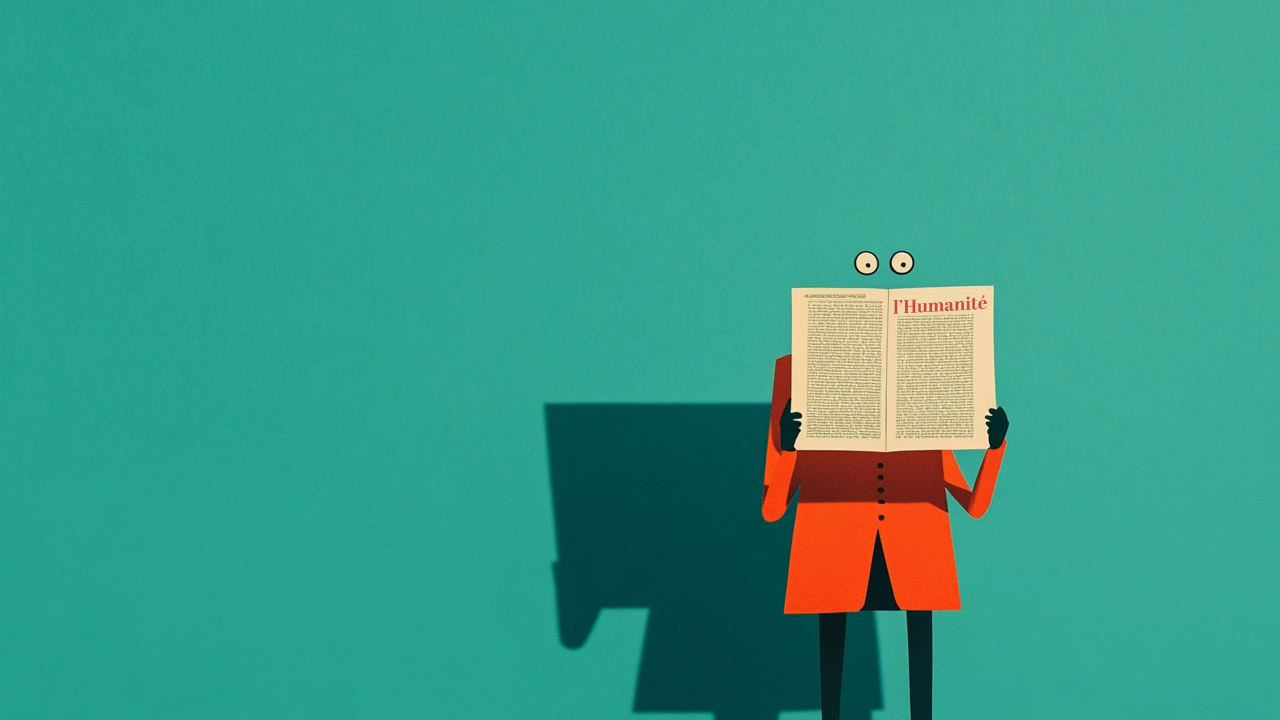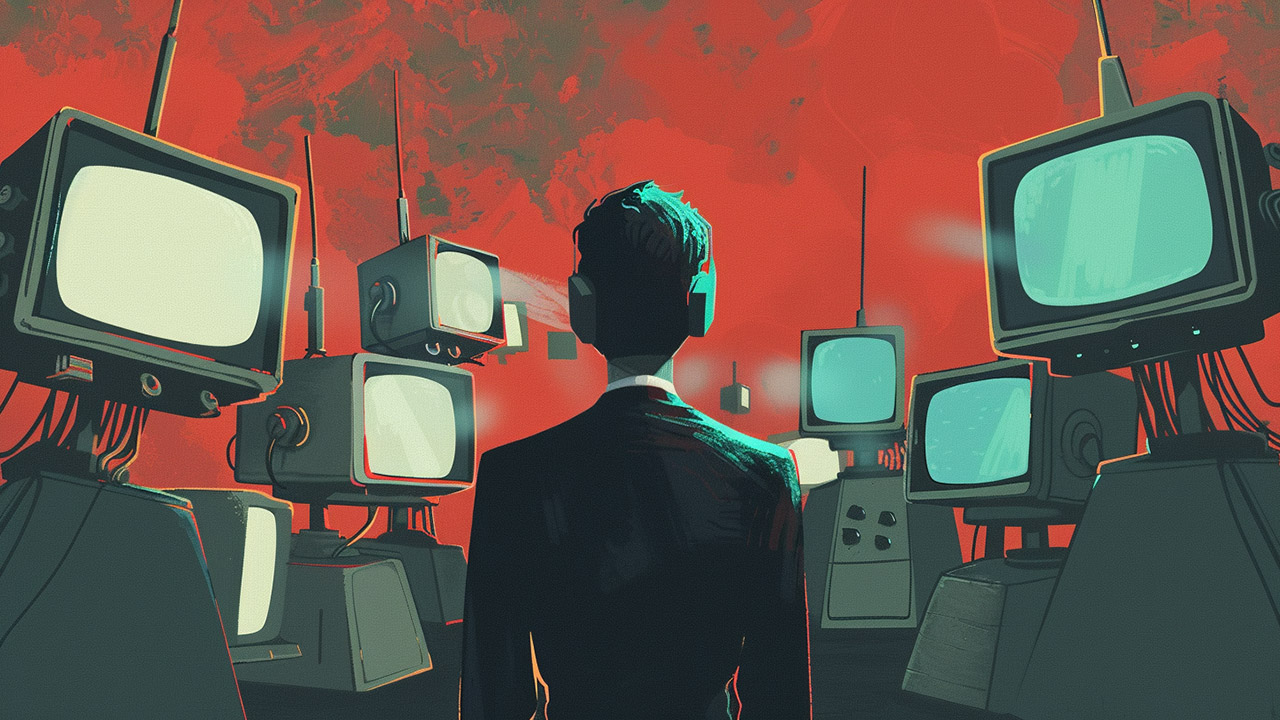Nous évoquions il y a peu la manière dont les démocraties modernes gouvernent au nom du bien. Dans un premier temps, nous avons montré comment la vertu s’est imposée comme instrument de pouvoir à l’intérieur même des sociétés libérales, la morale tenant lieu de contrainte politique. Dans un deuxième article, nous avons observé comment la vertu économique – justice sociale, redistribution, solidarité – se mue insensiblement en mécanisme de mise au pas et d’esclavage à travers l’exemple de la social-démocratie belge. Il restait un champ à explorer, celui des relations internationales, là où le discours moral atteint sa forme la plus extrême : la guerre. Voici le dernier texte de notre trilogie, toujours sous la plume de notre rédacteur Yves Lejeune.
Polémia
Les démocraties, dit-on, seraient pacifiques par nature. Pourtant, depuis un quart de siècle, ce sont elles qui ont le plus souvent pris les armes – et presque toujours au nom du bien. Elles ne déclarent plus la guerre : elles la mènent pour des causes. Elles ne cherchent plus à conquérir, mais à sauver ; elles ne visent plus à dominer, mais à protéger.
Ainsi s’est imposée, au fil des interventions, une nouvelle rhétorique : celle de la vertu armée, qui transforme chaque opération militaire en acte de conscience, chaque bombardement en geste humanitaire. Sous un champ lexical apaisant – “protéger”, “libérer”, “stabiliser” –, la guerre change de nature sans changer d’essence. Les chars avancent, mais sous la bannière des droits de l’homme. Les drones frappent, mais au nom de la démocratie. La morale n’est plus le frein de la puissance : elle en devient le moteur et l’alibi.
Cette mutation n’est pas née du hasard. Elle s’enracine dans les années 1990, au moment où l’Occident, privé d’ennemi idéologique après la chute du communisme, cherche une nouvelle justification à sa puissance. C’est alors qu’apparaît la doctrine du devoir d’ingérence, formulée par Mario Bettati et popularisée par Bernard Kouchner – cette idée qu’il existe, par-delà les frontières, une obligation morale d’intervenir pour “sauver des vies”. Le droit international, jusque-là fondé sur la souveraineté des États, s’incline devant la compassion érigée en norme. Dans son sillage, des personnages comme Bernard-Henri Lévy élèveront l’émotion au rang de boussole diplomatique, multipliant les tribunes et les voyages “humanitaires” qui préludent souvent à l’usage de la force. La guerre se pare alors de mots neufs : humanitaire, préventive, nécessaire, démocratique.
Mais l’histoire avait déjà connu cette alliance étrange de la vertu et de la violence. Sous la Révolution française, la « vertu républicaine » fut invoquée pour justifier les pires atrocités : au nom de la pureté morale, la Terreur traça une longue traînée de sang à travers le pays pour purger la France des « brigands », avant de se retourner contre ses propres enfants. Robespierre le disait sans détour :
« La vertu sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. »
Plus une cause se croit juste, plus elle s’autorise à être impitoyable. La morale, lorsqu’elle s’érige en absolu, cesse d’être un frein : elle devient une arme.
Depuis la guerre du Kosovo (1999), l’Occident a perfectionné cette grammaire de la guerre vertueuse. Chaque intervention s’accompagne d’un récit de salut : défense des droits de l’homme, lutte contre le terrorisme, protection des civils, promotion de la démocratie. Les objectifs stratégiques s’effacent derrière le voile moral : sous ces formules généreuses, c’est toujours l’intérêt qui se convertit en devoir. L’ennemi n’est plus un adversaire, il est le mal incarné – dictateur, terroriste, barbare –, et sa destruction devient une œuvre de justice.
De la Serbie à la Libye, de Kaboul à Kiev, un même schéma s’impose : l’Occident frappe au nom de la paix, détruit pour reconstruire, s’indigne pour dominer. C’est cette métamorphose du bien en justification de la violence qu’il faut interroger. Car si la conquête s’est effacée, le messianisme demeure : la vertu est devenue le langage politique de la puissance.
Avant d’examiner les grands conflits des vingt-cinq dernières années, il faut d’abord comprendre comment la morale, jadis limite du pouvoir, est devenue sa plus redoutable légitimation.
Le nouveau visage de la guerre : la vertu comme légitimité
- De la “guerre juste” à la “guerre humanitaire”
Pendant des siècles, la pensée occidentale a cherché à borner la violence par la morale. Chez saint Augustin, puis chez Thomas d’Aquin, la guerre n’était tolérable qu’à trois conditions : une autorité légitime, une cause juste et une intention droite – la paix. Cette doctrine de la guerre juste, reprise par Grotius et par les juristes du XVIIe siècle, visait à civiliser la force, à la contenir dans un cadre rationnel. Mais la modernité démocratique a inversé la formule : ce n’est plus la guerre qu’on moralise, c’est la morale qu’on militarise.
Après la chute du mur de Berlin, les États occidentaux, privés d’adversaire systémique, ont cherché une nouvelle raison d’être à leur puissance. La défense du “monde libre” ne suffisait plus : il fallait désormais défendre “l’humanité”.
C’est dans ce contexte qu’émerge la doctrine du devoir d’ingérence, concept forgé par le juriste Mario Bettati et popularisé par Bernard Kouchner à la fin des années 1980. Elle proclame qu’il existe un droit, voire un devoir, pour la communauté internationale d’intervenir lorsqu’un État ne protège plus sa population. La Charte des Nations unies, fondée sur la non-ingérence et la souveraineté des peuples, s’en trouve fragilisée. Le bien devient un motif d’intervention, la morale un passeport pour la guerre.
Dès les années 1990, cette doctrine se traduit en actes :
- en Somalie (Restore Hope, 1992), au nom de l’humanitaire ;
- en Bosnie (1995), au nom de la paix ;
- au Kosovo (1999), au nom de la protection des civils. L’OTAN bombarde Belgrade sans mandat de l’ONU : première rupture majeure du droit international depuis 1945. Mais la guerre est dite “morale”, donc acceptable. Le précédent est posé : lorsqu’une cause se prétend juste, elle se déclare légitime par elle-même.
Quelques années plus tard, cette logique sera officialisée par la doctrine onusienne de la Responsabilité de protéger (Responsibility to Protect, 2005), issue du rapport Evans-Sahnoun. L’idée est séduisante : la souveraineté n’est plus un droit absolu, mais une fonction subordonnée à la protection des populations. Dans les faits, elle ouvre la voie à un interventionnisme sélectif, fondé sur la puissance de ceux qui se disent vertueux. Depuis lors, chaque guerre occidentale s’annonce comme un sauvetage.
- La morale comme technologie de gouvernement international
Dans les régimes démocratiques, le pouvoir ne peut recourir à la guerre qu’à condition d’en moraliser la représentation. La légitimité n’est plus fondée sur la défense du territoire, mais sur la défense des valeurs. Ainsi naît une véritable technologie de gouvernement international, fondée sur la fabrique du consentement moral.
Les dirigeants ne s’adressent plus aux chancelleries, mais aux consciences. Chaque discours présidentiel, de Bill Clinton à Emmanuel Macron, prend la forme d’un plaidoyer moral : on ne frappe pas pour punir un ennemi, mais pour “prévenir un massacre”, “sauver des vies”, “défendre la démocratie”. Le vocabulaire est celui de la compassion et de la nécessité, non du calcul stratégique. Les États se présentent moins comme des puissances que comme des secouristes du monde.
Cette moralisation de la puissance repose sur une symbiose nouvelle entre diplomatie, médias et ONG. Les grandes organisations humanitaires – Médecins sans frontières, Human Rights Watch, Amnesty International – deviennent des acteurs de la scène diplomatique. Leurs rapports, souvent légitimes, nourrissent les argumentaires politiques ; leurs images alimentent la presse ; leurs mots entrent dans les résolutions du Conseil de sécurité. Le champ de la compassion devient celui de la décision militaire. Ainsi se forme une économie de la vertu, où la politique étrangère se mesure à l’aune de la sensibilité morale de l’opinion.
L’effet est redoutable : les démocraties modernes ne s’autorisent plus la guerre malgré elles, mais au nom d’elles-mêmes. Elles n’affirment plus leur puissance : elles affirment leur pureté. Ce n’est plus la raison d’État qui commande, mais la raison morale – plus contraignante encore, car elle interdit le doute. On ne peut discuter le bien sans paraître suspect. C’est pourquoi la guerre morale n’admet ni opposition ni nuance : elle se présente comme une évidence morale, non comme une décision politique.
- La grammaire de la guerre vertueuse
Ce mécanisme de justification n’est pas nouveau. La chercheuse belge Anne Morelli, dans Les Principes élémentaires de propagande de guerre (2001), a montré combien les régimes démocratiques reprennent, sous des formes modernes, les vieilles recettes du mensonge patriotique. Inspirée des travaux d’Arthur Ponsonby (1928), elle identifie dix lois immuables : nous ne voulons pas la guerre ; l’ennemi est seul responsable ; il incarne le mal absolu ; notre cause est noble ; nos crimes sont des erreurs ; les siens, des horreurs. Ces règles ne sont pas de simples manipulations : elles traduisent la logique profonde des sociétés qui se veulent vertueuses.
Ainsi, la propagande moderne ne glorifie plus la force : elle glorifie la bonté. Elle ne dit plus “nous vaincrons”, mais “nous sauverons”. Elle n’invoque plus Dieu ni la Nation, mais l’Humanité. Dans cette inversion du vocabulaire, tout est dit : la morale devient la dernière arme de l’Occident. Chaque guerre produit son récit rédempteur, ses images de victimes, ses figures du mal. Chaque opinion publique, convaincue d’agir pour une cause juste, devient complice d’une violence qu’elle ne voit plus.
Derrière les discours d’apaisement se déploie un imaginaire messianique : la conviction que le monde ne sera en paix que lorsqu’il ressemblera à nous. Ce moralisme globalisé se veut universel, mais il demeure profondément occidental : il suppose que la civilisation se confond avec la vertu, et la vertu avec notre modèle.
Ainsi s’installe, à la charnière du XXe et du XXIe siècle, un paradigme nouveau : la guerre morale. Non plus la guerre pour des ressources ou des territoires (rien ne change, mais il ne faut surtout pas en parler), mais la guerre pour des valeurs – ou, plus exactement, pour l’illusion de les incarner. La vertu est devenue la monnaie d’échange de la puissance. Elle permet de frapper sans se dire conquérant, de détruire sans se croire violent.
Dans les chapitres suivants, nous verrons comment ce paradigme s’est décliné, de la Yougoslavie à l’Ukraine, à travers une succession d’interventions où la morale s’érige en justification suprême – et où la paix, paradoxalement, ne cesse de s’éloigner.
« Une société de plus en plus égoïste et sauvage, en voie de primitivisme, paradoxalement dissimulée et compensée par le discours de la « morale unique », angélique et pseudo-humaniste. Voilà ce qui se remarque de plus en plus, année après année, jusqu’au point de rupture. »
Guillaume Faye
L’Archéofuturisme. Techno-science et retour aux valeurs ancestrales, éditions L’Æncre, 1998 et 2011, éditions L’Æncre/La Nouvelle Librairie, coll. Agora, 2023
Le dispositif de la guerre morale
- La fabrique du récit vertueux
Toute guerre moderne commence par une histoire. Une image, une rumeur, un cri. Le temps des mobilisations nationales est révolu : celui des mobilisations émotionnelles a pris le relais. Dans la guerre morale, l’ennemi ne se désigne plus par une frontière, mais par un récit. Ce récit doit d’abord émouvoir avant de convaincre : l’indignation précède la réflexion.
Depuis la fin du XXe siècle, la médiatisation instantanée a offert aux États une arme nouvelle : la compassion en temps réel. En 1990, la fausse histoire des bébés koweïtiens arrachés de leurs couveuses par les soldats irakiens fut relayée devant le Congrès américain par une jeune fille se présentant comme infirmière. L’opinion fut bouleversée ; la guerre du Golfe put commencer. L’affaire fut plus tard révélée comme une manipulation orchestrée par l’agence Hill & Knowlton, à la demande du gouvernement koweïtien. Le schéma était posé : une émotion fabriquée peut précipiter une décision stratégique.
Neuf ans plus tard, au Kosovo, la rhétorique se répète. Des médias occidentaux évoquent un “génocide” imminent de la population albanaise du Kosovo. Les chiffres évoqués alors – jusqu’à cent mille morts – seront, après guerre, revus à la baisse (environ 2 000 corps exhumés selon le Tribunal de La Haye). Mais l’opinion, saisie d’effroi, avait déjà consenti : l’OTAN pouvait frapper sans mandat de l’ONU. L’image précède la loi, la compassion supplante le droit.
Depuis lors, chaque conflit moral s’appuie sur la même dramaturgie :
1. un choc visuel (photo, vidéo, témoignage) ;
2. une interprétation morale immédiate (massacre, crime, barbarie) ;
3. une injonction à agir (“on ne peut pas rester sans rien faire”) ;
4. enfin, une justification a posteriori de la violence exercée.
La guerre devient une conséquence de l’émotion. Les réseaux d’information continue, les ONG et les diplomaties s’enchevêtrent dans un même espace d’indignation. La compassion se fait politique, et la politique se fait morale. Mais dans ce circuit fermé, la vérité devient secondaire : ce qui compte n’est pas la réalité du crime, mais la sincérité du sentiment.
- La sanctification du droit
La guerre morale ne se présente jamais comme une violation du droit, mais comme son accomplissement. Chaque intervention revendique une forme de légitimité juridique, même quand elle le contourne. L’opération de l’OTAN au Kosovo fut menée sans résolution du Conseil de sécurité : les juristes parlèrent d’une “guerre illégale mais légitime”. La formule, lancée par Madeleine Albright, résume tout : la légitimité morale prime sur la légalité internationale.
« Franchement, pour en revenir encore une fois au Kosovo, disons que le système a considéré que ce que nous avions fait là-bas n’était pas légal, mais que c’était juste. »
Madeleine Albright
Interview à NPR (National Public Radio), 26 septembre 2013, propos rapportés dans “Albright: U.N. Needs To Show Its Relevance On Syrian Issue”
En 2001, après les attentats du 11 septembre, l’invocation du droit à la légitime défense (article 51 de la Charte des Nations unies) permit de lancer la guerre d’Afghanistan. Deux ans plus tard, la même rhétorique servira à justifier l’invasion de l’Irak – sans mandat, sur la base de rapports d’armes inexistantes. Lorsque la vérité éclata, la guerre avait déjà eu lieu : le mensonge moral avait produit ses effets.
En 2005, l’ONU adopte la doctrine de la Responsabilité de protéger (R2P), qui reprend à son compte l’idée du devoir d’ingérence. Théoriquement, ce principe encadre l’usage de la force : elle doit être autorisée par le Conseil de sécurité et limitée à la protection des civils. Mais dans la pratique, il sert surtout à consacrer le droit d’intervention des puissants. Ainsi, la résolution 1973 sur la Libye (mars 2011), autorisant une “zone d’exclusion aérienne”, devint le prétexte à une campagne de bombardements visant à renverser Kadhafi. Quelques années plus tard, Vladimir Poutine justifiera son intervention en Crimée en invoquant… le même principe : protéger les populations russophones. La vertu, dès lors, n’a plus de camp : elle devient une arme de rhétorique universelle.
Le paradoxe de la guerre morale tient à ceci : elle prétend défendre le droit, mais elle le relativise dès qu’il entrave son élan. Le droit cesse d’être un cadre pour redevenir un instrument. Sous la façade de la légalité, on assiste à une dérive missionnaire : le juge se fait croisé.
- La mécanique médiatique : fabriquer la croyance
Les médias contemporains ne se contentent pas de relayer les récits : ils les produisent. Le philosophe français Jean Baudrillard l’avait déjà pressenti pendant la première guerre du Golfe : « La guerre du Golfe n’a pas eu lieu », écrivait-il, non pour nier les combats, mais pour souligner que la guerre, telle que perçue, n’existait plus qu’à travers son image. Ce constat vaut plus encore aujourd’hui : le champ de bataille s’est déplacé sur les écrans.
Dans les conflits récents, la guerre est simultanément filmée, commentée, justifiée. Les opérations de communication précèdent parfois les opérations militaires. Chaque mot compte : “frappes chirurgicales”, “dommages collatéraux”, “opérations de maintien de la paix”. Le lexique anesthésie la violence. À l’inverse, l’adversaire est toujours désigné par des termes disqualifiants : “régime”, “boucher”, “tyran”. Le vocabulaire moral fabrique l’évidence.
Les dix principes identifiés par Anne Morelli trouvent ici leur pleine application : “L’ennemi incarne le mal”, “nous ne faisons que nous défendre”, “ceux qui doutent sont des traîtres”. Ces formules, reprises à l’unisson par les chancelleries et les chaînes d’information, créent un champ discursif clos où la guerre devient indiscutable.
Les images d’archives confirment ce schéma :
- les ruines d’Alep présentées comme symbole de la barbarie d’Assad, sans mention des groupes armés présents dans la ville ;
- les frappes sur Bagdad filmées de nuit, esthétisées comme un feu d’artifice propre ;
- les conférences de presse à Kiev où chaque mot de “résistance” et de “liberté” renvoie à un imaginaire moral universel.
La morale s’incarne dans l’image : plus elle semble pure, plus elle justifie. Les démocraties ont appris à faire la guerre en direct et sans honte – non parce qu’elles auraient cessé de tuer, mais parce qu’elles ont appris à bien la raconter.
- La mise en scène du progrès
Le propre des guerres morales est de se présenter non comme des destructions, mais comme des commencements. Elles promettent un “après” lumineux : des élections libres, des institutions modernes, des droits nouveaux. Chaque intervention s’accompagne de promesses de reconstruction et de démocratisation. Ainsi, l’Irak devait devenir un modèle pour le Moyen-Orient ; l’Afghanistan, un État de droit respectueux des femmes ; la Libye, un pays prospère et apaisé. Aucune de ces promesses n’a été tenue.
Ce récit du progrès est pourtant essentiel : il neutralise la culpabilité. Il permet de présenter la guerre non comme une tragédie, mais comme une pédagogie. On ne détruit pas pour soumettre, mais pour “éduquer” ; on ne bombarde pas pour punir, mais pour “faire évoluer”. C’est le retour du vieux rêve occidental : transformer la guerre en école du bien.
Dans cette vision, l’Occident se perçoit non comme un acteur, mais comme un tuteur moral du monde. Il ne conquiert plus des territoires, il convertit des consciences. Et lorsqu’il échoue, il se défausse : ce sont les peuples eux-mêmes, dit-on, qui “n’étaient pas prêts à la démocratie”. Ainsi, la guerre morale, même dévastatrice, conserve toujours le dernier mot : celui de la vertu.
Au terme de ce dispositif, la boucle est bouclée : la compassion justifie l’ingérence, le droit sanctifie la force, les médias fabriquent le récit, et le progrès en promet l’issue heureuse. Ce quadrillage narratif rend toute guerre moralement soutenable, à condition qu’elle soit menée par ceux qui se disent civilisés.
Le chapitre suivant en exposera les déclinaisons concrètes, à travers huit conflits majeurs – du Kosovo à l’Ukraine – où cette vertu armée s’est exprimée avec éclat, transformant la morale en l’un des langages les plus redoutables de la puissance.
Rétrospective : un quart de siècle de guerres vertueuses (1999-2025)
De la Yougoslavie à l’Ukraine, la guerre morale a trouvé dans chaque décennie son théâtre d’expression. Les motifs changent, les instruments évoluent, mais la logique demeure : l’Occident frappe au nom du bien, convaincu d’incarner la conscience du monde. Ces huit cas permettent d’observer la répétition d’un même schéma narratif : émotion initiale, rhétorique morale, consensus médiatique, effondrement du droit, chaos final.
- Kosovo (1999) : la guerre humanitaire inaugurale
Officiellement, l’intervention de l’OTAN visait à “protéger les Albanais du Kosovo menacés d’un génocide”. Les médias occidentaux parlaient de charniers, de “nettoyage ethnique” à grande échelle. Aucun mandat du Conseil de sécurité n’ayant été obtenu, les frappes furent lancées unilatéralement. Les bombardements durèrent soixante-dix-huit jours et firent plusieurs centaines de victimes civiles, notamment lors du bombardement de la RTS à Belgrade. Après la guerre, les enquêtes du Tribunal de La Haye recensèrent environ deux mille corps, loin des chiffres initiaux. La “guerre humanitaire” était née : illégale en droit, mais jugée “légitime” en conscience.
- Afghanistan (2001-2021) : la guerre juste contre le mal
Au lendemain du 11 septembre, les États-Unis invoquent l’article 51 de la Charte de l’ONU : légitime défense contre Al-Qaïda. L’objectif moral est clair : “éradiquer le terrorisme” et “libérer le peuple afghan”, notamment les femmes. La coalition internationale réunit quarante-huit pays. Vingt ans plus tard, le régime tombe en quelques jours, les talibans reprennent Kaboul, et les promesses de démocratie s’effondrent. Le pays sort ruiné, plus divisé que jamais. La guerre la plus longue de l’histoire américaine se conclut par le retour exact du régime qu’elle prétendait abolir. La morale avait justifié l’occupation ; le réel en révéla la vanité.
- Irak (2003) : le mensonge vertueux
Washington accuse Saddam Hussein de détenir des armes de destruction massive et d’entretenir des liens avec le terrorisme. Colin Powell présente ses “preuves” devant l’ONU : tubes d’aluminium, fioles suspectes, photos satellites.
Tout sera démenti par la suite. Mais la rhétorique morale – “libérer le peuple irakien”, “apporter la démocratie” – l’emporte. L’invasion commence sans mandat. Bagdad tombe, le régime s’effondre, et avec lui l’équilibre régional. La guerre crée Daech, engendre plus de cent mille morts civils et fragilise durablement le Moyen-Orient. L’argument humanitaire laisse place à un chaos géopolitique d’où les États-Unis ne sortiront pas honorés.
- Libye (2011) : protéger les civils, renverser un État
Sous l’impulsion de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis, le Conseil de sécurité adopte la résolution 1973 : autorisation d’intervenir pour “protéger la population de Benghazi”. En quelques semaines, l’opération “Unified Protector” se transforme en campagne de bombardements. Kadhafi est renversé et assassiné. Dix ans plus tard, la Libye est morcelée, livrée aux milices, aux trafics d’armes et à la traite d’êtres humains. L’intervention, saluée comme un succès moral, aura détruit l’un des États les plus stables d’Afrique. Le sinistre Bernard-Henri Lévy parlera d’“ingérence réussie” : la formule résume toute l’illusion du bien armé.
- Syrie (2011-) : la guerre moralisée à distance
Dès les premières manifestations, la narration occidentale oppose un “régime criminel” à un “peuple en révolte”. Les armes chimiques deviennent le point de bascule : chaque accusation relance la menace d’intervention, sans preuve décisive. Les États-Unis et la France frappent ponctuellement, tout en soutenant des groupes rebelles dont certains rejoignent des mouvances djihadistes. Résultat : un pays dévasté, plus de 400 000 morts, des millions de réfugiés. La morale sélective interdit toute lecture géopolitique : ceux qui soulignent la complexité du conflit sont accusés de complaisance envers le “tyran”. La guerre médiatique remplace la diplomatie.
- Mali et Sahel (2013-2022) : la vertu post-coloniale
Lorsque l’armée française intervient au Mali en janvier 2013, l’opération “Serval” est présentée comme un acte de solidarité africaine : “empêcher l’effondrement d’un État ami”, “lutter contre le terrorisme”. Quelques années plus tard, “Barkhane” succède à “Serval” et s’enlise. Malgré les succès tactiques, les groupes armés se multiplient, la population s’exaspère, les gouvernements locaux vacillent. La France est accusée de néocolonialisme, ses soldats quittent progressivement le terrain. La morale antiterroriste, censée justifier la présence militaire, finit par nourrir la méfiance. L’ingérence au nom du bien se heurte à la fatigue des peuples.
- Coalition contre Daech (2014-) : la guerre absolue contre le mal
Après la diffusion des vidéos d’exécutions de journalistes et de civils, la coalition internationale se forme autour d’un mot d’ordre : “éradiquer le mal absolu”. Plus de 80 États participent, avec l’appui symbolique de pays arabes. L’ennemi est moralement incontestable. Les bombardements massifs détruisent Mossoul et Raqqa ; les civils périssent par milliers. L’État islamique recule, mais la région s’enfonce dans une instabilité chronique. La guerre morale, ici, atteint sa perfection : aucune pitié, aucune opposition possible, car celui qui combat le mal est, par définition, du côté du bien.
- Ukraine (2014-2025) : la vertu géopolitique
L’invasion russe de février 2022 ravive le récit binaire : démocratie contre autocratie, civilisation contre barbarie. Le président Zelensky devient l’incarnation du courage moral, tandis que Vladimir Poutine est désigné comme le “mal absolu”. Les États-Unis et l’Union européenne justifient un engagement sans précédent – sanctions économiques, livraisons d’armes, encadrement médiatique – au nom de la “défense de la liberté”. Mais la guerre s’enlise, les pertes se chiffrent en centaines de milliers, et l’Europe s’enferme dans une économie de guerre durable. La morale de la résistance s’est muée en logique de confrontation permanente. Plus la cause est vertueuse, plus elle devient infinie.
En un quart de siècle, la guerre morale a produit une forme d’inversion tragique : les démocraties se battent pour des principes qu’elles n’appliquent plus, au nom d’une humanité qu’elles fragmentent. La compassion justifie l’ingérence, l’ingérence entretient le chaos, et le chaos appelle de nouvelles interventions. Le bien, devenu arme politique, ne connaît plus de cesse.
Nous allons maintenant analyser ce paradoxe dans toute sa profondeur : comment la morale, loin d’apaiser le monde, en est venue à perpétuer la guerre en la rendant supportable.
Anatomie d’un récit vertueux
Le propre des guerres morales n’est pas seulement de se justifier par la vertu : c’est d’en adopter le langage, les symboles et les affects. La force s’avance sous les traits de la compassion ; l’opération militaire se confond avec le devoir moral. Chaque intervention reproduit une dramaturgie presque immuable : le mal surgit, l’émotion s’empare des consciences, la communauté internationale “ne peut rester sans rien faire”, et la guerre devient l’unique moyen de sauver la paix.
- La vertu comme anesthésiant critique
La première fonction de la vertu guerrière est d’abolir le doute. Quand une guerre se prétend juste, celui qui la questionne cesse d’être un citoyen : il devient un suspect moral. L’espace public se referme sur une morale binaire où toute nuance devient trahison. C’est la mécanique qu’Anne Morelli a parfaitement décrite : “ceux qui doutent sont des traîtres”. Le débat stratégique se transforme en querelle de conscience ; la critique du réel est disqualifiée au profit du registre moral.
Dans ce climat, l’indignation remplace l’analyse. L’émotion ne précède plus la politique : elle la dicte. Des images d’enfants syriens asphyxiés aux civils ukrainiens sous les bombes, chaque conflit s’accompagne d’un choc visuel qui interdit la distance. Or l’émotion, comme le rappelait Raymond Aron, “ne fonde pas une politique” : elle la rend impossible. Plus le discours moral se déploie, plus la réflexion stratégique s’éteint.
Cette anesthésie du jugement s’étend jusqu’au vocabulaire. Les mots “paix”, “valeurs”, “humanité” deviennent des instruments d’adhésion, non de pensée. Ils fonctionnent comme des formules de foi : y croire suffit. Le citoyen ne soutient plus une politique, il communie dans une cause.
- La guerre morale comme économie de croyance
Le second trait du récit vertueux est d’entretenir la croyance dans la pureté de ses armes. Les démocraties libérales ne peuvent accepter d’être violentes ; elles doivent se penser bienveillantes jusque dans l’usage de la force. D’où la prolifération d’un vocabulaire technologique et moral à la fois : “frappes chirurgicales”, “zéro mort civil”, “opérations de précision”. Le progrès technique devient garant d’éthique ; la machine se substitue à la conscience.
Cette illusion d’innocence nourrit une économie complète de la croyance. Les institutions parlent le langage de la transparence ; les médias, celui de la compassion ; les armées, celui de la maîtrise. Ensemble, elles composent un récit d’efficacité morale : l’Occident ne tue pas, il “neutralise” ; il ne bombarde pas, il “stabilise”. La violence change de nature parce qu’elle change de mots.
Cette logique n’est pas neuve : déjà pendant la guerre du Vietnam, les porte-parole américains évoquaient des “zones pacifiées” pour désigner des territoires rasés. Mais la guerre morale va plus loin : elle transforme le crime en pédagogie. Détruire devient instruire. Les ruines de Tripoli ou de Mossoul, filmées en haute définition, sont présentées comme le prix nécessaire du progrès. L’imagerie du bien rend la souffrance supportable.
- La morale comme substitut à la stratégie
La guerre morale est d’autant plus dangereuse qu’elle se croit dispensée de penser. Puisqu’elle est juste, elle n’a pas besoin d’être cohérente. Les objectifs se dissolvent dans la vertu : on ne définit plus ce qu’on veut, on dit ce qu’on doit. Le résultat importe moins que l’intention. C’est ainsi que les États-Unis ont pu quitter l’Afghanistan en proclamant “une mission accomplie” alors que tout y était perdu : le langage moral tenait lieu de bilan.
Dans cette perspective, chaque échec devient une occasion de recommencer. Si l’intervention échoue, c’est qu’elle n’a pas été assez morale. La faillite n’invalide pas la logique ; elle la relance. Ce mécanisme d’auto-justification explique la permanence du cycle interventionniste : Kosovo, Irak, Libye, Ukraine… La morale fonctionne comme une énergie inépuisable : elle autorise tout, sauf l’introspection.
Les grandes puissances réalistes calculent ; les puissances vertueuses croient. Or, dans les affaires du monde, la croyance est souvent plus destructrice que le cynisme. Quand le bien se prend pour la stratégie, il devient aveugle à ses conséquences. Le “nation building”, les sanctions “ciblées”, les “missions de formation” prolongent la guerre sous d’autres formes, parce que le bien, convaincu de son rôle, ne sait pas s’arrêter.
- Le récit du progrès comme absolution
Pour clore la boucle, le discours moral offre toujours une rédemption. La guerre n’est jamais une fin : elle est le commencement d’un avenir meilleur. Les ruines sont la promesse d’un monde reconstruit sur des valeurs nouvelles. Dans les années 2000, Washington rêvait d’un “Grand Moyen-Orient démocratique” ; en Europe, on parlait d’“élargir la zone de paix”. À chaque fois, le futur sert d’absolution au présent.
Ce récit rédempteur accomplit la fonction d’un catéchisme politique : il remplace la justification par la prophétie. Ce n’est plus le résultat qui compte, mais la direction morale du mouvement. L’histoire doit finir par prouver que nous avions raison. Et si elle ne le fait pas, c’est qu’elle n’est pas encore achevée.
C’est ainsi que la guerre morale devient infinie : parce qu’elle ne combat jamais un ennemi concret, mais un principe du mal. Et l’on ne fait pas la paix avec un principe.
Le récit vertueux fonctionne donc comme une architecture complète : émotion, droit, médias, croyance, absolution. Il n’a pas besoin de vaincre pour durer ; il lui suffit de convaincre. La guerre morale est une guerre qui se gagne à domicile : dans les esprits. C’est là que réside sa force, mais aussi son danger : elle remplace la lucidité par la ferveur et transforme la puissance en sermon.
Ce que révèle la vertu guerrière
La guerre morale n’est pas un accident : c’est l’expression achevée d’une époque qui a remplacé la foi religieuse par une théologie politique du « bien », et la conquête par la mission. Ces notions fonctionnent comme des dogmes : elles ne se discutent pas, elles s’imposent. L’historien Marcel Gauchet a décrit l’Occident moderne comme une “société sortie de la religion” mais non de la croyance.
- La sélectivité morale : vertu pour les uns, silence pour les autres
L’un des traits les plus frappants de ce système est sa sélectivité. L’indignation n’est jamais universelle, elle est géopolitique. Les victimes qui intéressent l’Occident ne sont pas celles qui souffrent le plus, mais celles dont la souffrance sert une cause politique. Le principe de “Responsabilité de protéger” s’applique à la Libye, mais pas au Yémen ; à l’Ukraine, mais pas à la Palestine ; à la Bosnie, mais pas au Rwanda. Le droit humanitaire devient une boussole morale à géométrie variable.
Les États occidentaux ne choisissent pas leurs guerres en fonction de leur gravité morale, mais de leur rentabilité symbolique. Plus un conflit permet de mettre en scène la supériorité de nos valeurs, plus il devient légitime. Ce n’est pas la misère qui appelle la vertu, mais la visibilité : sans caméras, il n’y a pas de conscience. Les zones d’ombre du monde – Sahel, Haut-Karabakh, Éthiopie – ne suscitent qu’un intérêt intermittent, faute d’enjeux médiatiques ou stratégiques. Ainsi, le bien lui-même devient un privilège géopolitique.
- Le brouillage du droit et de la morale
En vingt-cinq ans, la guerre morale a profondément brouillé les fondements du droit international. L’usage de la force, jadis strictement limité, s’est enveloppé de considérations éthiques qui en dissolvent la rigueur. On ne parle plus d’agression ni d’invasion, mais d’“intervention préventive”, de “frappes proportionnées”, de “protection des populations”. Le vocabulaire de la morale remplace celui du droit, et la subjectivité du sentiment supplante la clarté des normes.
Ce brouillage est lourd de conséquences : il affaiblit la crédibilité de ceux qui s’en réclament. Comment dénoncer la violation d’une souveraineté lorsque l’on pratique soi-même l’ingérence ? Comment invoquer le droit international contre la Russie après l’avoir contourné au Kosovo ou en Irak ? L’Occident, en moralissant la guerre, a miné l’universalité du droit qu’il prétend défendre. Il s’est placé au-dessus des règles au nom de la vertu – comme si le bien dispensait de la loi.
Le résultat est paradoxal : plus le discours moral se généralise, plus la loi perd de force. Les nations qui se disent civilisées deviennent des puissances d’exception, convaincues que leur pureté d’intention les absout de toute faute. La morale, jadis limite du pouvoir, devient son passe-droit.
- La fatigue morale de l’Occident
À force d’invoquer la vertu, l’Occident s’épuise. Il veut croire qu’il agit pour sauver le monde, mais il ne sait plus pourquoi ni comment. Ses croisades humanitaires se succèdent sans mémoire, sans victoire et sans retour. Chacune laisse derrière elle un vide que la suivante s’empresse de combler. Le moralisme permanent finit par tourner à la lassitude. Les peuples, abreuvés d’images et de sermons, ne croient plus vraiment à la pureté de ces entreprises, mais n’osent pas davantage les contester. La guerre morale ne mobilise plus, elle use.
Cette fatigue morale se traduit aussi par un désarroi intérieur. En projetant sa vertu sur le monde, l’Occident a cessé de la pratiquer chez lui. Il s’indigne à distance, mais tolère l’injustice à proximité. Il parle d’humanité universelle, mais redoute l’effort, la durée, la tragédie. Sa morale est instantanée, sa compassion volatile. Le monde, lui, s’est durci : il ne croit plus à ces croisades du bien, et les interprète comme des stratégies d’influence. La vertu, devenue suspecte, ne convainc plus personne.
- Le retour du tragique
La guerre morale traduit enfin une illusion plus profonde : celle d’un monde où le mal pourrait être éradiqué. Les démocraties modernes refusent la part tragique de la politique. Elles veulent une histoire sans culpabilité, des guerres sans morts, des victoires sans domination. Or la réalité demeure tragique : chaque guerre, même juste, engendre des innocents tués, des sociétés détruites, des haines durables. L’oubli de ce tragique conduit à l’hybris morale – cette certitude d’avoir raison quoi qu’il en coûte.
En prétendant abolir le mal, les démocraties finissent par le produire. Elles imposent la paix par la force, la liberté par l’occupation, la justice par le désordre. La morale ne pacifie plus : elle arme. Ce n’est plus une limite à la puissance, mais une arme de plus dans son arsenal.
La vertu comme miroir et camouflage
La guerre au nom du bien n’est pas seulement un paradoxe, c’est un symptôme. Elle révèle la fragilité d’un monde qui ne sait plus agir sans se raconter qu’il agit pour l’humanité. La vertu sert de miroir à la puissance : elle lui permet de se regarder sans honte. Mais elle en est aussi le camouflage : elle cache la domination sous les apparences du salut.
Loin d’être pacifiques, les démocraties libérales se sont dotées d’un instrument d’intervention d’autant plus redoutable qu’il s’ignore lui-même. Leur guerre n’est plus une guerre déclarée, mais une guerre déniée – conduite au nom du bien, donc présumée innocente. Pourtant, le résultat est là : des pays ruinés, des peuples déplacés, un droit international fragilisé, et une opinion occidentale de plus en plus désabusée.
À force de vouloir incarner la morale, l’Occident en a perdu la mesure. Il ne conquiert plus : il convainc. Il ne pille plus : il sauve. Mais sous cette grammaire de la bonté, la même logique persiste – celle de la puissance. La morale a pris le relais du canon, et la vertu celui de la victoire. Le bien, lorsqu’il se fait armé, finit toujours par se nier lui-même.
Épilogue
L’Occident moderne s’est voulu libéré de la religion. Il a cru rompre avec le dogme et la transcendance. Il a remplacé le salut des âmes par le progrès des sociétés, la foi en Dieu par la foi en l’homme, la promesse du paradis par celle d’un monde enfin plus juste. Mais il n’a pas cessé de croire. Sa croyance a simplement changé d’objet.
La religion de la vertu, née des Lumières et radicalisée par la Révolution française, s’est muée en une mystique laïque. Ses temples sont les organisations internationales, ses Évangiles les déclarations universelles, ses prêtres les experts et les éditorialistes. Cette religion sans Dieu a ses péchés (la haine, le nationalisme, l’inégalité) et ses sacrements (les sanctions, les interventions, les commémorations). Elle n’offre plus le salut éternel, mais la rédemption immédiate.
Ainsi s’explique l’arrogance tranquille avec laquelle nos démocraties mènent la guerre. Il ne s’agit plus de dominer, mais de sauver. Le discours du bien abolit la culpabilité, il confond la force et la vertu. Et cette illusion morale, parce qu’elle repose sur une foi sincère, est plus redoutable que le cynisme d’autrefois. L’empire conquérant savait qu’il imposait sa loi ; l’empire vertueux croit rendre service à l’humanité.
Pourtant, cette foi morale s’épuise. L’Occident ne convainc plus. Ses croisades humanitaires ont laissé derrière elles des ruines, ses sermons sur les « valeurs » se heurtent au scepticisme.
Comment sortir de ce non-sens ? Non pas en rejetant toute morale, mais en la réordonnant. Il ne s’agit pas de renoncer au bien, mais de rompre avec le moralisme. Retrouver la mesure, c’est reconnaître que la politique n’est pas la charité, que la justice n’est pas l’innocence, que la paix ne se construit pas contre le tragique mais à partir de lui. Il faut réapprendre à penser la puissance sans honte, à accepter la complexité du monde, à distinguer le devoir moral du délire missionnaire.
Ce retour à la lucidité suppose une révolution intérieure : substituer à la « foi dans le bien » une éthique du réel. Comprendre que la vertu n’est pas une bannière, mais une discipline – non pas ce qui s’impose aux autres, mais ce qui s’impose à soi. Les civilisations ne se sauvent pas par la pureté, mais par la vérité.
C’est sans doute le chemin de sortie : redevenir moral sans se croire sauveur. Accepter que l’homme ne rachète pas le monde, qu’il ne fait que l’habiter. Retrouver une forme de modestie civilisatrice, cette sagesse que les Anciens appelaient prudence, les chrétiens charité, et que nos modernes confondent avec la faiblesse.
Alors seulement, peut-être, la vertu retrouvera son sens premier : non plus le masque de la force, mais sa limite.
Yves Lejeune
Bibliographie indicative
- Hugo Grotius, De iure belli ac pacis (Du droit de la guerre et de la paix), 1625. Édition de référence : Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, trad. Paul Pradier-Fodéré, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2012.
- Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1962.
- Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde : une histoire politique de la religion, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1985.
- Mario Bettati, Le droit d’ingérence : mutation de l’ordre international, Paris, Odile Jacob, 1996 (concept coélaboré avec Bernard Kouchner au sein du “Groupe international du droit d’ingérence humanitaire”, années 1980-1990).
- Bernard Kouchner, Le malheur des autres, Paris, Odile Jacob, 1991 (recueil de textes fondateurs de la doctrine du devoir d’ingérence).
- Anne Morelli, Principes élémentaires de propagande de guerre (utilisables en cas de guerre froide, chaude ou tiède), Bruxelles, Éditions Labor, 2001.
- Rapport Evans–Sahnoun, The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), Ottawa, International Development Research Centre (IDRC), décembre 2001. Concept entériné par le Sommet mondial de l’ONU, World Summit Outcome Document, A/RES/60/1, 24 octobre 2005.
- Bernard-Henri Lévy, La Guerre sans l’aimer : journal d’un écrivain au cœur du printemps libyen, Paris, Grasset, 2011 (chronique de l’intervention occidentale en Libye sous angle humanitaire et démocratique).
Du même auteur
- Gouverner par la vertu : le despotisme doux des démocraties libérales contemporaines
- Belgique : État social, dette et servitude
- Suisse : une souveraineté à rude épreuve
- Saint-Pétersbourg : une réunion internationale de conservateurs crée la surprise
- Crise dans la crise : l’art de détourner l’attention
Pour aller plus loin
- Venezuela : le choc et l’oubli - 10 janvier 2026
- Ukraine : quand la géographie revient réclamer ses droits - 7 janvier 2026
- Politique-fiction : et si la France se dirigeait vers une situation « à la belge » ? - 10 octobre 2025


 Soutenez Polémia, faites un don ! Chaque don vous ouvre le droit à une déduction fiscale de 66% du montant de votre don, profitez-en !
Soutenez Polémia, faites un don ! Chaque don vous ouvre le droit à une déduction fiscale de 66% du montant de votre don, profitez-en !